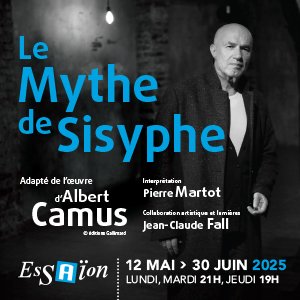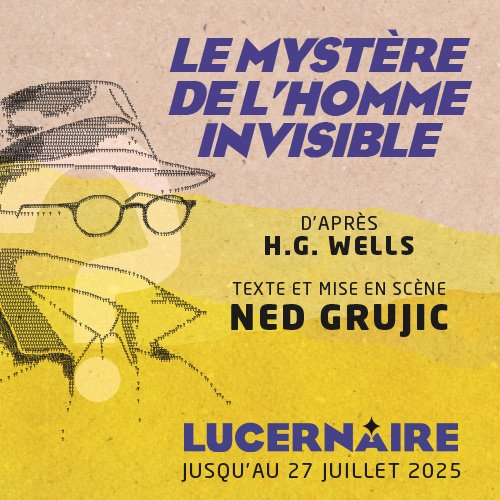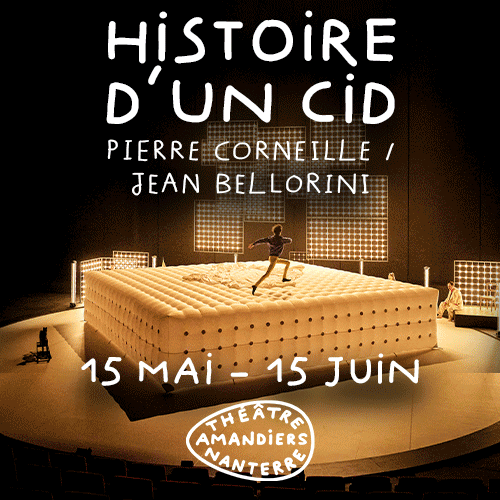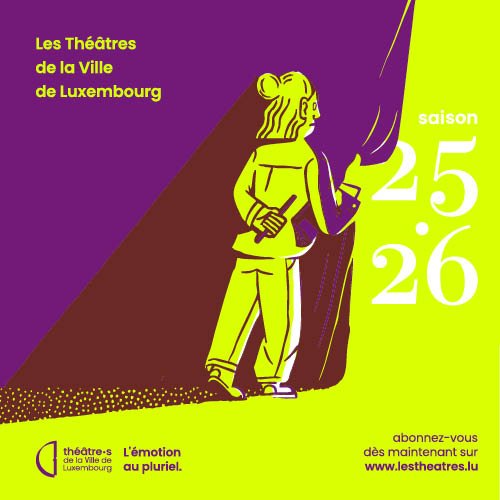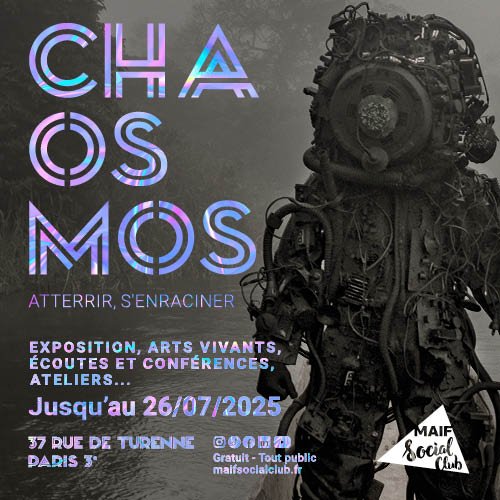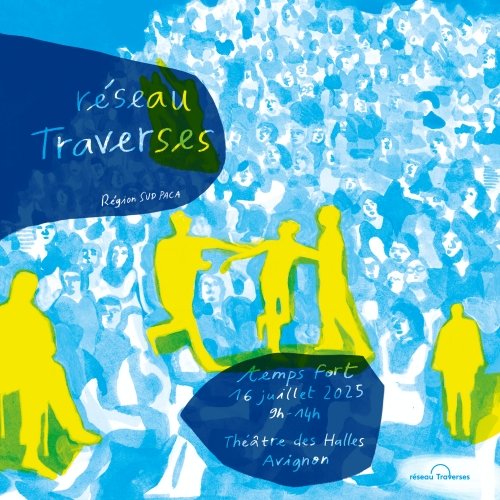Qu’est-ce que Passages ?
Benoît Bradel : Ce mot est plein d’échos. Le Festival est né à Nancy, sur les souvenirs du Festival mondial du théâtre, initié par Jack Lang. C’était un événement complètement fou, qui avait retourné la ville et les esprits. Quand Charles Tordjman a repris la direction du théâtre de la Manufacture, le Centre dramatique national implanté dans la ville, les habitants et les spectateurs lui disaient : « C’est sympa ton théâtre, mais on a connu un festival qui nous a secoués. »
De cet engouement de tout un territoire, il a décidé d’en créer un nouveau. C’était peu après la chute du Mur de Berlin, et ce qui a fait sa force et sa marque de fabrique, était de regarder vers l’Est. Inviter des metteurs en scène venus de Pologne, d’Ukraine, de Russie, de Lituanie… Au début, il y avait trois ou quatre spectacles, puis un peu plus. C’était un nouveau souffle.
Comment êtes-vous arrivé dans l’aventure ?

Benoît Bradel : J’avais croisé le festival de loin, à l’époque. Mais quand l’opportunité s’est présentée, c’est comme si tout s’alignait. J’avais dirigé un petit festival nomade en Bretagne, j’ai toujours été attiré par les formes hybrides, par le voyage — j’ai eu la chance de travailler sur Le Mahabharata de Peter Brook, où il y avait des artistes du monde entier sur scène.
Et puis, j’étais arrivé à un moment de mon parcours où j’avais envie d’autre chose. Moins de créations personnelles, plus de temps partagé avec d’autres artistes. Imaginer un lieu, un espace, une dynamique. Je ne connaissais pas Metz. Et pourtant… j’en suis tombé amoureux.
Vous avez rebaptisé l’événement Passages Transfestival. Pourquoi ce changement ?
Benoît Bradel : Parce qu’on changeait de cap. Il fallait redonner de l’élan. Passages avait déjà ouvert ses portes à la Méditerranée, à l’Afrique… Mais j’avais envie d’assumer pleinement la notion de « trans » : transculturel, transdisciplinaire, transgénérationnel. Et puis on est à Metz, ville transfrontalière par excellence. Le mot avait donc un sens.
Je voulais qu’on sorte du théâtre pur pour aller vers quelque chose de plus vivant, de plus contemporain. Qu’on fasse dialoguer les formes. Aujourd’hui, les artistes n’appartiennent plus à une seule case : ils croisent les disciplines, les langues, les héritages. Le festival devait être à leur image.
Ce virage a aussi été accompagné d’un changement de rythme ?

Benoît Bradel : Passages était devenu une biennale. Et j’ai vite senti que le public s’y perdait ainsi que les partenaires. C’est très difficile de construire une équipe, une dynamique, sur ce tempo-là. J’ai voulu rendre le festival annuel, plus lisible, plus ancré.
Et au-delà de ces deux semaines de mai, on essaie aussi d’exister toute l’année, en organisant des ateliers, des résidences, des rencontres afin que la présence artistique ne s’arrête pas à l’effervescence du festival.
Et comment fait-on dialoguer cette ambition internationale avec un territoire comme Metz, parfois perçu comme un peu replié ?
Benoît Bradel : C’est un vrai travail de terrain. Mais Metz est une ville de passage, justement. Elle a été allemande deux fois, elle est redevenue française, elle est habitée par plusieurs communautés, italienne, portugaise, maghrébine… Il y a un esprit d’ouverture que je ressens fortement.
On travaille aussi avec des artistes qui vivent ici, ou dans le Grand Est, mais qui ont des parcours internationaux. On tisse, on croise, on fait circuler. Et surtout, on fait confiance au public, : à sa curiosité, à son goût de l’ailleurs.
Comment se construit votre programmation ?
Benoît Bradel : J’ai envie de présenter des artistes qui tentent, qui cherchent, qui croisent les écritures. Des formes singulières, parfois encore peu vues, mais puissantes. Des artistes qui m’interrogent, qui me bousculent.
Je pense par exemple à Hatice Özer, que nous avons accompagnée depuis sa première pièce. Ou à Lia Rodrigues, Gisèle Vienne, que j’ai voulu faire venir pour la première fois ici. J’aime quand un spectacle soulève des questions, donne de la force.
Et je m’attache aussi à garder un équilibre : entre des artistes émergents qu’on accompagne et des figures plus installées, capables de remplir de grandes salles. Le populaire et l’expérimental, sans les opposer.
Votre modèle économique est fragile…

Benoît Bradel : Très. Chaque édition, c’est un petit miracle. On a des soutiens solides : la Ville, la Région, la DRAC, le Département. Mais on doit compléter à chaque fois, aller chercher des moyens supplémentaires. On est une petite équipe, mais très mobilisée, très agile.
Cette année, on a dû réduire un peu la voilure. Pas de grandes salles, mais des formes plus légères, plus mobiles, qui gardent toute leur puissance. Et on espère pouvoir élargir à nouveau l’an prochain : ce seront les 30 ans de l’association, les 15 ans à Metz, les cinq ans du Transfestival.
En dehors du festival, vous accompagnez aussi les artistes toute l’année ?
Benoît Bradel : Oui, de plus en plus. On organise des résidences avec les partenaires locaux. En ce moment, on accueille par exemple Muna Mussie une jeune artiste érythréo-italienne. On a aussi lancé un atelier mensuel, appelé ZIG ZAG le premier mardi du mois, ouvert à tous : amateurs, pros, personnes en situation de handicap. C’est un moment de pratique partagée, pas un cours. C’est très fort.
Et puis, on est aussi présents dans les écoles, en prison… Il y a un vrai travail d’éducation artistique et de transmission que j’aimerais encore développer.
Et pour l’édition 2025, quelle est la ligne artistique ?

Benoît Bradel : Le thème cette année, c’est Libère l’avenir. Le titre Liberte O Futuro vient d’un livre d’une journaliste brésilienne, Eliane Brum, qui a choisi de s’installer en Amazonie pour être au cœur des luttes : écologiques, féministes, sociales.
On vit une époque de grande incertitude, d’anxiété. J’avais envie d’offrir un espace à des artistes qui osent imaginer l’après. Et notamment aux plus jeunes. Leur regard est clair, courageux. Ils ne se laissent pas abattre. Ils ont des clés.
Parmi les grands temps forts, il y a l’ouverture avec Soliloquio de Tiziano Cruz, artiste autochtone argentin, qui va travailler avec des associations de Metz. Le spectacle Monga de Jéssica Teixeira, créé par une artiste brésilienne en situation de handicap, est aussi un moment fort. C’est puissant, joyeux, bouleversant.
Par ailleurs, il y a aussi tous les moments conçus avec La Casa do Povo, lieu incroyable à São Paulo où nous irons aussi en novembre prochain faire un micro festival dans le cadre de la saison croisée France Brésil. Et puis beaucoup de petites formes, de parcours, de possibilités de voyager d’une esthétique à l’autre. Le festival, pour moi, c’est ça : un espace où l’on peut changer de regard, d’angle, grandir un peu. Un moment d’émancipation collective.
Propos recueillis par Olivier Frégaville-Gratian d’Amore
Passages Transfestival
du 15 au 25 mai 2025
Metz